
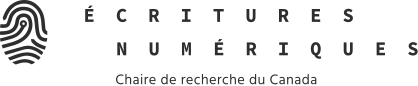
Introduction
Qu’est-ce que la littérature?
- Les humanae litterae
Qu’est-ce que la philosophie?
Qu’est-ce que ce et
Des axes
- La littérature pense la philosophie
- La philosophie pense la littérature
- La littérature fait de la philosophie
La littérature pense la philosophie
- La représentation littéraire de la philosophie
- Les figures littéraires de philosophe
- Le littérature contribue à produire une idée de philosophie
La philosophie pense la littérature
- La philosophie de la littérature
- La théorie de la littérature
- Penser le rôle de la littérature
La littérature fait de la philosophie
- La littérature philosophique
- Au delà des limites de la philosophie
- au delà du langage philosophique
- anticiper la philosophie
Un corpus
- Un cours institutionnel
- Les classiques
- Le statut symbolique de la philosophie
Le sexisme de la philosophie cf. Shapiro, Lisa. « Revisiting the Early Modern Philosophical Canon ». Journal of the American Philosophical Association 2, nᵒ 3 (ed 2016): 365‑83. https://doi.org/10.1017/apa.2016.27.
- La philosophie et l’institution
Calendrier
- 5 septembre - Introduction
- 12 septembre - La représentation littéraire de la philosophie: Aristophane, Les nuées
- 19 septembre - Philosophie de la littérature - Platon, République (livres II, III, X)
- 26 septembre - Philosophie de la littérature - Aristote, La poétique
- 3 octobre - Philosophie de la littérature - Martha Nussbaum, Maria Zambrano
- 10 octobre - Littérature philosophique - Voltaire Candide
- 17 octobre - Littérature philosophique - Sartre, La nausée
- 24 octobre - Semaine de lecture - Rendu 1
- 31 octobre - Littérature philosophique - Sartre, La nausée
- 7 novembre - Littérature philosophique - de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée
- 14 novembre - Littérature philosophique - Valéry, Eupalinos ou l’architecte
- 21 novembre - Littérature philosophique - Proust, Recherche
- 28 novembre - Littérature philosophique - Borges, L’immortel, L’Aleph
- 5 décembre - Conclusion - Rendu 2
12 septembre
La représentation littéraire de la philosophie: Aristophane
19 septembre
Philosophie de la littérature - Platon, République
26 septembre
Philosophie de la littérature - Aristote, La poétique
3 octobre - Philosophie de la littérature
10 octobre - Littérature philosophique - Voltaire Candide
17 et 31 octobre - Littérature philosophique - Sartre, La nausée
7 novembre - Littérature philosophique - de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée
14 novembre - Littérature philosophique - Valéry, Eupalinos ou l’architecte
21 novembre - Littérature philosophique - Proust, Recherche
28 novembre - Littérature philosophique - Borges, L’immortel, L’Aleph
Rendus
- Wikipédia sur un de sujets: différentes contributions + compte rendu d’expérience - 24 Octobre
- Participation et annotation (hypothes.is)
- Texte critique sur stylo à propos d’une des oeuvres - 5 décembre
Wikipédia - 24 octobre
- Contribution sur Wikipédia sur des thématiques liées au cours. Les contributions doivent être:
- Des ajouts (au moins 1 ajout majeur et 5 ajouts mineurs)
- Des corrections de forme (au moins 5)
- Wikification (au moins 5)
- Participation à la discussion (au moins 2)
- Compte-rendu d’expérience d’environ 3000 signes espaces compris déposé sur votre espace wikipédia personnel.
Texte - 5 décembre
Un texte d’approfondissement sur une œuvre traitée dans le cours (10.000caractères). Le texte analysera les aspects suivants:
- Contexte historique et littéraire
- Déscription de l’oeuvre
- Rapport littérature-philosophie
Le texte doit être écrit avec Stylo ou en markdown et ensuite transformé en HTML.
Comment faire?
Critères d’évaluation
- Structure générale (clarté de l’argumentation) : 30 %
- Contexte historique et littéraire : /10 %
- Déscription de l’oeuvre : /10 %
- Rapport littérature-philosophie : /10 %
Pertinence de l’analyse (choix des arguments et des exemples, liens avec le texte étudié, explications) : 40 %
Compétences techniques (les consignes relatives au format sont-elles respectées ?) : 15 %
Langue (orthographe, grammaire, syntaxe) : 15%
Outils…
- text editor
- isidore.science
- Zotero
- Hypothes.is
Les Nuées d’Aristophane
Le contexte historique
- Athènes au Ve siècle
- La victoire des guerres médiques (Salamine 480 av.JC)
- L’apogée de la culture athénienne
- Périclès
- Reconstruction de l’acropole
- La guerre du Péloponnèse 432-404
- Le changement social et culturel
- crise des valeurs de la cité
- bien-être et prospérité
- L’importance de l’art oratoire
- La naissance de la sophistique
- La figure de Socrate
Le contexte littéraire
- La tragédie et la comédie
- Les fêtes dionysiaques : des festivals de théâtre
- Le Komos
Aristophane
- 445-380 ca
- Le seul resté
- 11 comédies restées
Les nuées
- 423 av.J.C.
- Une critique de la culture contemporaine
- Socrate et les sophistes
- La corruption des jeunes
- les Nuées: divinités d’une pensée fumeuse
Une guerre de valeurs
- individualisme vs collectivisme
- richesse, costumes raffinés vs simplicité et valeurs traditionnels (campagne et ville)
- la comédie - comme genre - est réactionnaire!
- faire plaisir au public
- rétablir la règle (comique significatif)
- prospérité sociale : goûts de luxe vs valeurs de la guerre (guerres médiques)
- liberté vs licence
La représentation de la philosophie
- relativisme des sophistes
- recherche philosophique qui ne porte à rien
- inutilité de la philosophie
- mettre tout en question
- contre le bon sens
- nouveauté
- le paradoxe de la critique des valeurs traditionnels (entre esprit critique et constructivisme)
Platon
République : contexte
- La cité idéale
- Un enjeux d’éducation
- La politique réelle - Syracuse et Dion
République II et III
- le vrai et l’utile (ne pas raconter des histoires sur les dieux)
- rôle pédagogique du récit : même des récits faux peuvent servir (mais le mensonge est réservé à une élite)
- reconstruire une vérité à des fins politiques - 389b dire le faux à des fins politiques
- le raisonnement prime sur le mythe
- la poésie est dangereuse - parce qu’elle est agréable
plus ils sont pleins de poésie, plus ils sont dangereux pour des enfants et des hommes 387b
- mimesis et tromperie (ex. du discours direct 393c)
Rôle de la littérature et des mythes
- langage beau (agréable) au lieu que vrai
- mimesis comme tromperie
- Lecture des mythes. Quel est le degré d’ironie?
- beaucoup de passages littéraires
- le mythe est un moyen de transporter la vérité
Oppositions
- rationalité - poésie
- récits vrais/faux (poésie est du côté du faux) - valeur de vérité
- vérité ou valeur politique ?
- imitation liée au discours direct (tromperie)
- imitation de la vertu: discours unitaire et style unique
Livre X
- le topos de la mimesis comme illusion
- rejet absolu de la mimesis (plus radical que dans le livre II et III)
- orienté par une approche ontologique - et non littéraire
- 3 plans : idées, choses, représentation des choses
- mathématique et dianoia
Livre X
- question de la connaissance (ce qui explique les exemples sur les artefacts)
- instrumentalité (utilité)
- technes (fusion de connaissance et compétence technique)
- exemple de la flûte: celui qui se sert de la flûte en sait plus sur ce qu’est la flûte
- savoir faire et connaître la vérité
- valeur morale/valeur de vérité (de la mimesis)
- émotions et contrôle des émotions
- il est plus difficile d’imiter le caractère sage
- pour plaire le poète imite des sujets bas
Aristote
Un “manuel” de littérature
- Valeur préscriptive
L’épopée la poésie tragique, la comédie, la poésie dithyrambique, l’aulétique, la citharistique, en majeure partie se trouvent être toutes, au résumé, des imitations
- Classement des œuvres selon les moyens, les objets et les modes
- Moyens: rythme, musique, mètre
- Objets: noble ou bas
- Modes: narration ou représentation (imitent en agissant)
Schémas
- tragédie :
- moyens : langage et musique,
- objets : caractères nobles
- modes: spectacle
- proportion et équilibre de la fable (comme proportion des parties des animaux) - même plan ontologique par rapport à la beauté
- entre prescription et description : Iliade et Odyssée comme exemples d’unité d’action
La mimesis
- Importance de l’imitation:
Le fait d’imiter est inhérent à la nature humaine dès l’enfance; et ce qui fait différer l’homme d’avec les autres animaux, c’est qu’il en est le plus enclin à l’imitation : les premières connaissances qu’il acquiert, il les doit à l’imitation, et tout le monde aime les imitations. - Fable : chose la plus importante. Imitation d’actions. Ce qui compte est la structuration des faits.
Ontologies
- Définition contextuelle de commencement (faiblesse ontologique) :
Le commencement est ce qui ne vient pas nécessairement après autre chose, mais est tel que, après cela, il est naturel qu’autre chose existe ou se produise ; la fin, c’est cela même qui, au contraire, vient après autre chose par une succession naturelle, ou nécessaire, ou ordinaire, et qui est tel qu’il n’y a plus rien après ; le milieu, c’est cela même qui vient après autre chose, lorsqu’il y a encore autre chose après.
Les fonctions de la poésie
- fonction : apprentissage.
Cela tient à ce que le fait d’apprendre est tout ce qu’il y a de plus agréable non seulement pour les philosophes, mais encore tout autant pour les autres hommes ; seulement ceux-ci ne prennent qu’une faible part à cette jouissance.
- différence et similitude avec Platon. Pour A. la simulation est utile comme simulateur de vol - débat contemporain
- haut et bas et rapport avec Platon
catharsis
La tragédie est l’imitation d’une action grave et complète, ayant une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable et de telle sorte que chacune des parties qui la composent subsiste séparément, se développant avec des personnages qui agissent, et non au moyen d’une narration, et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la même nature.
- donc deux fonctions: apprentissage et catharsis
- caractère pragmatique d’Aristote - moins de lien ontologie=morale (comme chez Platon)
Statut ontologique de la mimesis
- supériorité de la poésie sur l’histoire
Aussi la poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus élevé que l’histoire ; car la poésie parle plutôt de généralités, et l’histoire de détails particuliers.
- différence fondamentale avec Platon (critique de la mimesis comme représentation de la réalité - moins que réel)
- valeur ontologique de la poésie
- dunaton et entelekeia !!!! différence par rapport à Métaph (9,3 poétique).
- livre 25 et “erreurs” poétiques
Les règles de l’art
- Prescriptif – donc le règles de l’art devant la vie. Il ne faut pas raconter la vérité, mais produire une structure (13,3 et 4)
- ambigüité: fidélité aux fables et à l’histoire (encore rapport entre dunaton et entelekeia)
- nécessaire et vraisemblable : Or il faut, dans les moeurs comme dans la constitution des faits, toujours rechercher ou le nécessaire, ou la vraisemblance
- reconnaissance : la tragédie fonctionne comme le réel
- correspondance forme et contenu - voilà pourquoi toute la partie sur le langage est importante
- 24,12
Il faut adopter les impossibilités vraisemblables, plutôt que les choses possibles qui seraient improbables, et ne pas constituer des fables composées de parties que la raison réprouve, et en somme n’admettre rien de déraisonnable, ou alors, que ce soit en dehors du tissu fabuleux.
- épisode du bain d’Ulysse comme paralogisme cf auerbach (24,8)
- vrais erreurs : non de correspondance, mais de cohérence interne. (25) Des impossibilités ont été imaginées, c’est une faute; mais c’est correct, si le but de l’art est atteint.
Poésie et pensée
Zambrano
- 1904-1991
- Espagne en ’36
- Filosofía y poesía 1940
Poésie et pensée
- 2 moitiés de l’être humain
- étonnement, extase et négation rationnelle de l’extase
La philosophie est une extase qu’un déchirement fait échouer
L’ambiguïté de Platon
- Celui qui semblait être né pour la poésie a choisi la philosophie
- Socrate et le Phédon
Multiplicité et unité
- la multiplicité dédaignée
- la contradiction
- poésie et unité (la parole est unité, dépassement de l’étonnement multiple)
La question politique
- Les poètes n’ont pas gouverné une République
- Politique et contradictions
Marthe Nussbaum
- 1947 -
- Professeure à l’Université de Chicago
- Philosophie ancienne
- Féminisme
- Une philosophe dans l’isntitution
Amour et connaissance
- 2 modèles opposés:
- intellectualisme
- approche émotionnelle
Intellectualisme
- Les émotions dérangent le savoir
- Raison vs. émotion
Le savoir cataleptique
- katalambanein: saisir
- compréhension immédiate (Stoïciens)
- Mais comment en faire une “science” et ne pas tomber dans le solispisme ?
Apprendre à tomber
- Réconcilier les opposés
- Avec les autres
- Savoir immédiat et rationalité
La littérature
- Nécessité de la narration
- Complexité
- Littérature toute seule?
- L’aide de la philosophie
- Littérature et philosophie nécessaires pour la connaissance
Voltaire
Contexte
- 1759
- Voltaire dans son jardin
- Maturité - vieillesse
- Tremblement de terre de Lisbone 1755
Le problème du mal
- impossibilité théorique du mal
- le manichéisme
Leibniz
- La rationalité de Leibniz
- Les mondes possibles
- Le principe de raison
L’optimisme
- un néologisme
- Leibniz et l’optimisme
L’encyclopédie du mal
- mal physique et mal moral
- situations et personnages (stylisés)
L’absurde
- accepter l’absurde?
- rapport expérience/pensée
Rationalité et irrationalité
- L’embaras de Voltaire
- Comment dire l’irrationnel?
Francesco Orlando et la formation de compromis
- la théorie freudienne de la littérature
- la formation de compromis
- l’exemple des objets désuets
- l’impératif fonctionnel - impératif rationnel
- l’ironie
Sartre
Jean-Paul Sartre
- 1905-1980
- La découverte de la phénoménologie
- Le travail comme professeur au Havre
- 1928: rencontre avec de Beauvoir
- 1936: L’imagination
- 1936: première version de La Nausée (Mélancholia), refusée par Gallimard
- 1938: sortie de la Nausée
- 1943 L’Être et le néant
- 1945 La renommée et la mode de l’existentialisme
La phénoménologie
- L’être et le phénomène
- Husserl et l’épochè phénoménologique
- Aux choses!
L’existentialisme
- L’être et l’existence
- La fin de l’essence
Existentialisme et pessimisme
- S’il n’y a pas l’essence on est seul
- Si Dieu n’existe pas… la mort de Dieu de Nietzsche
- Existentialisme et désespoir?
Contingence
- Il n’y a rien de nécessaire
- Le dégoût pour l’existant
- La contingence
Existentialisme et optimisme
- S’il n’y a pas l’essence on est responsable
- L’importance de l’action
- Existentialisme et humanisme
- La liberté
La nausée
La nausée
- Un roman philosophique
- Mettre en scène une intuition
- Le “journal”
Le mieux serait d’écrire les événements au jour le jour. Tenir un journal pour y voir clair. Ne pas laisser échapper les nuances, les petits faits, même s’ils n’ont l’air de rien, et surtout les classer. Il faut dire comment je vois cette table, la rue, les gens, mon paquet de tabac, puisque c’est cela qui a changé. Il faut déterminer exactement l’étendue et la nature de ce changement.
La nausée
- La découverte de l’être là
- La nausée
Maintenant je vois ; je me rappelle mieux ce que j’ai senti, l’autre jour, au bord de la mer, quand je tenais ce galet. C’était une espèce d’écœurement douceâtre. Que c’était donc désagréable ! Et cela venait du galet, j’en suis sûr, cela passait du galet dans mes mains, Oui, c’est cela, c’est bien cela : une sorte de nausée dans les mains.
Sa chemise de coton bleu se détache joyeusement sur un mur chocolat. Ça aussi ça donne la Nausée. Ou plutôt c’est la Nausée. La Nausée n’est pas en moi : je la ressens là-bas sur le mur, sur les bretelles, partout autour de moi. Elle ne fait qu’un avec le café, c’est moi qui suis en elle.
La nausée
- Contingence
Ce moment fut extraordinaire. J’étais là, immobile et glacé, plongé dans une extase horrible. Mais, au sein même de cette extase quelque chose de neuf venait d’apparaître ; je comprenais la Nausée, je la possédais. A vrai dire je ne me formulais pas mes découvertes. Mais je crois qu’à présent, il me serait facile de les mettre en mots. L’essentiel c’est la contingence. Je veux dire que, par définition, l’existence n’est pas la nécessité. Exister, c’est être là, simplement ; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire.
La nausée
- Rollebon et l’échec de l’Histoire
Mais pas un livre d’histoire, ça parle de ce qui a existé — jamais un existant ne peut justifier l’existence d’un autre existant. Mon erreur, c’était de vouloir ressusciter M. de Rollebon.
La nausée
- Les aventures
- Situations privilégiées, moments parfaits
- La nécessité
Moi, j’ai eu de vraies aventures. Je n’en retrouve aucun détail, mais j’aperçois l’enchaînement rigoureux des circonstances.
Mais aujourd’hui, à peine ai-je prononcé ces mots, que je suis pris d’une grande indignation contre moi-même : il me semble que je mens, que de ma vie je n’ai eu la moindre aventure, ou plutôt je ne sais même plus ce que ce mot veut dire.
Je n’ai pas eu d’aventures. Il m’est arrivé des histoires, des événements, des incidents, tout ce qu’on voudra. Mais pas des aventures. Ce n’est pas une question de mots ; je commence à comprendre. Il y a quelque chose à quoi je tenais plus qu’à tout le reste — sans m’en rendre bien compte. Ce n’était pas l’amour, Dieu non, ni la gloire, ni la richesse. C’était… Enfin je m’étais imaginé qu’à de certains moments ma vie pouvait prendre une qualité rare et précieuse. Il n’était pas besoin de circonstances extraordinaires : je demandais tout juste un peu de rigueur.
Les aventures sont dans les livres. Et naturellement, tout ce qu’on raconte dans les livres peut arriver pour de vrai, mais pas de la même manière. C’est à cette manière d’arriver que je tenais si fort.
La nausée
- Les histoires
Une histoire, par exemple, comme il ne peut en arriver, une aventure. Il faudrait qu’elle soit belle et dure comme de l’acier et qu’elle fasse honte aux gens de leur existence.
Un livre. Un roman. Et il y aurait des gens qui liraient ce roman et qui diraient : « C’est Antoine Roquentin qui l’a écrit, c’était un type roux qui traînait dans les cafés », et ils penseraient à ma vie comme je pense à celle de cette Négresse : comme à quelque chose de précieux et d’à moitié légendaire. Un livre.
La nausée
- Le rôle de la littérature
Se méfier de la littérature. Il faut écrire au courant de la plume ; sans chercher les mots.
La nausée
- Some of these days
- Un disque
- La nécessité
On a dû rayer le disque à cet endroit-là, parce que ça fait un drôle de bruit. Et il y a quelque chose qui serre le cœur : c’est que la mélodie n’est absolument pas touchée par ce petit toussotement de l’aiguille sur le disque. Elle est si loin — si loin derrière. Ça aussi, je le comprends : le disque se raye et s’use, la chanteuse est peut-être morte ; moi, je vais m’en aller, je vais prendre mon train. Mais derrière l’existant qui tombe d’un présent à l’autre, sans passé, sans avenir, derrière ces sons qui, de jour en jour, se décomposent, s’écaillent et glissent vers la mort, la mélodie reste la même, jeune et ferme, comme un témoin sans pitié.
Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoir
- 1908-1986
- La bourgeoisie
- L’émancipation
- 1929: l’agrégation et Castor
- Sartre
- 1943 L’invitée
Simone de Beauvoir
- Le féminisme: 1949, Le deuxième sexe
- 1954 Les Mandarins: Gouncourt
- 1958 Mémoires d’une jeune fille rangée
La curiosité de savoir
Ce que je comprenais le moins, c’est que la connaissance conduisît au désespoir. Le prédicateur n’avait pas dit que les mauvais livres peignaient la vie sous des couleurs fausses : en ce cas, il eût facilement balayé leurs mensonges ; le drame de l’enfant qu’il avait échoué à sauver, c’est qu’elle avait découvert prématurément l’authentique visage de la réalité. De toute façon, me disais-je, un jour je la verrai moi aussi, face à face, et je n’en mourrai pas : l’idée qu’il y a un âge où la vérité tue répugnait à mon rationalisme.
La philosophie
Elles expliquèrent en outre à ma mère que la philosophie corrodait mortellement les âmes : en un an de Sorbonne, je perdrais ma foi et mes mœurs.
Ce qui m’attira surtout dans la philosophie, c’est que je pensais qu’elle allait droit à l’essentiel. Je n’avais jamais eu le goût du détail ; je percevais le sens global des choses plutôt que leurs singularités, et j’aimais mieux comprendre que voir ; j’avais toujours souhaité connaître tout ; la philosophie me permettrait d’assouvir ce désir, car c’est la totalité du réel qu’elle visait ; elle s’installait tout de suite en son cœur et me découvrait, au lieu d’un décevant tourbillon de faits ou de lois empiriques, un ordre, une raison, une nécessité.
Savoir et émancipation
À travers une étude sur Kant, je me passionnai pour l’idéalisme critique qui me confirmait dans mon refus de Dieu. Dans les théories de Bergson sur « le moi social et le moi profond » je reconnus avec enthousiasme ma propre expérience.
Comme dans un roman
- L’influence de la littérature:
- Little women
- Le Moulin sur la Floss
- Grand Meaulnes
La littérature prit dans mon existence la place qu’y avait occupée la religion : elle l’envahit tout entière, et la transfigura. Les livres que j’aimais devinrent une Bible où je puisais des conseils et des secours ; j’en copiai de longs extraits ; j’appris par cœur de nouveaux cantiques et de nouvelles litanies, des psaumes, des proverbes, des prophéties et je sanctifiai toutes les circonstances de ma vie en me récitant ces textes sacrés.
La vocation pour l’écriture
Pourquoi ai-je choisi d’écrire ? Enfant, je n’avais guère pris au sérieux mes gribouillages ; mon véritable souci avait été de connaître ; je me plaisais à rédiger mes compositions françaises, mais ces demoiselles me reprochaient mon style guindé ; je ne me sentais pas « douée ». Cependant, quand à quinze ans j’inscrivis sur l’album d’une amie les prédilections, les projets qui étaient censés définir ma personnalité, à la question : « Que voulez-vous faire plus tard ? » je répondis d’un trait : « Être un auteur célèbre. » Touchant mon musicien favori, ma fleur préférée, je m’étais inventé des goûts plus ou moins factices. Mais sur ce point je n’hésitai pas : je convoitais cet avenir, à l’exclusion de tout autre. La première raison, c’est l’admiration que m’inspiraient les écrivains ; mon père les mettait bien au-dessus des savants, des érudits, des professeurs. J’étais convaincue moi aussi de leur suprématie ; même si son nom était largement connu, l’œuvre d’un spécialiste ne s’ouvrait qu’à un petit nombre ; les livres, tout le monde les lisait : ils touchaient l’imagination, le cœur ; ils valaient à leur auteur la gloire la plus universelle et la plus intime. En tant que femme, ces sommets me semblaient en outre plus accessibles que les pénéplaines ; les plus célèbres de mes sœurs s’étaient illustrées dans la littérature
La vocation pour l’écriture
De retour à Meyrignac, je songeai à écrire ; je préférais la littérature à la philosophie, je n’aurais pas du tout été satisfaite si l’on m’avait prédit que je deviendrais une espèce de Bergson ; je ne voulais pas parler avec cette voix abstraite qui, lorsque je l’entendais, ne me touchait pas. Ce que je rêvais d’écrire, c’était un « roman de la vie intérieure » ; je voulais communiquer mon expérience.
L’écriture comme sens
Ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais.
L’écriture comme sens
L’aventure surtout est un leurre, je veux dire cette croyance en des connexions nécessaires, et qui pourtant existeraient. L’aventurier est un déterministe inconséquent qui se supposerait libre. » Comparant sa génération à celle qui l’avait précédée, Sartre concluait : « Nous sommes plus malheureux, mais plus sympathiques. »
Cette dernière phrase m’avait fait rire ; mais en causant avec Sartre j’entrevis la richesse de ce qu’il appelait sa « théorie de la contingence », où se trouvaient déjà en germe ses idées sur l’être, l’existence, la nécessité, la liberté. J’eus l’évidence qu’il écrirait un jour une œuvre philosophique qui compterait. Seulement il ne se facilitait pas la tâche, car il n’avait pas l’intention de composer, selon les règles traditionnelles, un traité théorique. Il aimait autant Stendhal que Spinoza et se refusait à séparer la philosophie de la littérature. À ses yeux, la contingence n’était pas une notion abstraite, mais une dimension réelle du monde : il fallait utiliser toutes les ressources de l’art pour rendre sensible au cœur cette secrète « faiblesse » qu’il apercevait dans l’homme et dans les choses. La tentative était à l’époque très insolite ; impossible de s’inspirer d’aucune mode, d’aucun modèle
Roman de formation
- L’émancipation
- Se libérer du passé (la mort de Jacques et Zaza)
Paul Valéry
Paul Valéry
- 1871-1945
- poète symboliste
- influence de Mallarmé
- résistance
Paul Valéry
| Mouvement | immobilité |
|---|---|
| Vivants | morts |
| Architecture | écriture |
| Imaginaire | réel (actuel) |
| Multiplicité | unité |
| Virtuel | actuel |
| sensible | intelligible |
| réel | langage |
| pensée-action | pensée abstraite |
| architecture | philosophie |
| production d’espace | mauvaise mimesis (représentation) |
| construire | connaître |
| être | connaître |
| homme | esprit |
Concepts-clés
- Mysticisme du réel (réel comme point de fuite de dynamiques virtuelles)
- Formel sensible
- sensibilité créatrice (et donc imaginaire)
- imaginaire incarné (au milieu dans l’opposition être-connaître, réel-langage)
Multiplicité vs Unité
- les morts sont l’unité (il pensent une seule chose). Acte vs puissance - cf Léonard
Je t’ai dit que je suis né plusieurs, et que je suis mort, un seul. L’enfant qui vient est une foule innombrable, que la vie réduit assez tôt à un seul individu, celui qui se manifeste et qui meurt. Une quantité de Socrates est née avec moi, d’où, peu à peu, se détacha le Socrate qui était dû aux magistrats et à la ciguë.
Contre la philosophie
Il en est ainsi dans tous les domaines, à l’exception de celui des philosophes, dont c’est le grand malheur qu’ils ne voient jamais s’écrouler les univers qu’ils imaginent, puisque enfin ils n’existent pas.
Représentation
- objets morts
Imposer à la pierre, communiquer à l’air, des formes intelligibles ; n’emprunter que peu de chose aux objets naturels, n’imiter que le moins du monde, voilà bien qui est commun aux deux arts.
La sensibilité
Tu me fais revivre. Ô langage chargé de sel, et paroles véritablement marines !
L’imaginaire construit le réel
- La force de la littérature
Ô mon ami, tu ne trouves donc pas admirable que la vue et le mouvement soient si étroitement unis que je change en mouvement un objet visible, comme une ligne ; et un mouvement en objet ? Que cette transformation soit certaine, et la même toujours, et qu’elle le soit au moyen de la parole ? La vue me donne un mouvement, et le mouvement me fait sentir sa génération et les liens du tracement. Je suis mû par la vue ; je suis enrichi d’une image par le mouvement, et la même chose m’est donnée, que je l’aborde par le temps, que je la trouve dans l’espace… Ô mon ami, tu ne trouves donc pas admirable que la vue et le mouvement soient si étroitement unis que je change en mouvement un objet visible, comme une ligne ; et un mouvement en objet ? Que cette transformation soit certaine, et la même toujours, et qu’elle le soit au moyen de la parole ? La vue me donne un mouvement, et le mouvement me fait sentir sa génération et les liens du tracement. Je suis mû par la vue ; je suis enrichi d’une image par le mouvement, et la même chose m’est donnée, que je l’aborde par le temps, que je la trouve dans l’espace…
Construire ou connaître
Il faut choisir d’être un homme, ou bien un esprit. L’homme ne peut agir que parce qu’il peut ignorer, et se contenter d’une partie de cette connaissance qui est sa bizarrerie particulière, laquelle connaissance est un peu plus grande qu’il ne faut !
Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges
- 1889 Buenos Aires - 1986 Genève
- 1938 : bibliotécaire à Buenos Aires
- 1946 : il perd son poste à cause de ses positions antipéronistes
- 1944 : Fictions
- 1944-52 : L’Aleph
- 1950 : “invention” par Roger Caillois
- 1953 : traduction de Caillois - Labyrinthes
- 1955 après coup d’État contre Peron, il est élu directeur de la Bibliothèque nationale
- 1960 : il devient aveugle
- 1969 Elogio de la sombra
L’infini
- Spatial
- Temporel
- Potentiel
- Actuel
L’impensable
- limites de la rationalité
- limites du langage
L’immortel
- L’importance des noms
- Cartaphilus
- Pope
- Marcus Flaminius Rufus (Mars)
- Homère
Immortalité et identité
Elle [la république des Immortels] savait qu’en un temps infini, toute chose arrive à tout homme. Par ses vertus passées ou futures, tout homme mérite toute bonté ; mais également toute trahison par ses infamies du passé et de l’avenir. Ainsi, dans les jeux de hasard, les nombres pairs et impairs tendent à s’équilibrer ; ainsi s’annulent l’astuce et la bêtise, et peut-être le grossier poème du Cid est-il le contrepoids exigé par une seule épithète des Églogues ou par une maxime d’Héraclite. La pensée la plus fugace obéit à un dessein invisible et peut couronner, ou commencer, une forme secrète. J’en connais qui faisaient le mal pour que le bien en résulte dans les siècles à venir ou pour qu’il en soit résulté dans les siècles passés… À cette lumière, tous nos actes sont justes, mais ils sont aussi indifférents. Il n’y a pas de mérites moraux ou intellectuels. Homère composa L’Odyssée ; aussitôt accordé un délai infini avec des circonstances et des changements infinis, l’impossible était de ne pas composer, au moins une fois, L’Odyssée. Personne n’est quelqu’un, un seul homme immortel est tous les hommes.Comme Corneille Agrippa, je suis dieu, je suis héros, je suis philosophe, je suis démon et je suis monde, ce qui est une manière fatigante de dire que je ne suis pas.
Immortalité et identité
… Au bout d’un an, j’ai relu ces pages ; je m’assure qu’elles ne trahissent pas la vérité, mais dans les deux premiers chapitres et même dans quelques paragraphes des suivants, il me semble percevoir quelque chose de faux. C’est peut-être la conséquence de l’abus des détails circonstanciels, procédé que j’ai appris chez les poètes et qui fait tout paraître faux ; car pareils détails abondent bien dans la réalité, mais nullement dans la mémoire qu’on en a… Cependant, je crois avoir découvert une raison plus cachée. Je la dirai ; peu m’importe qu’on me juge fantastique. L’histoire que j’ai racontée paraît irréelle parce qu’en elle s’entrelacent les événements arrivés à deux individus distincts. Dans les premiers chapitres, le cavalier veut savoir le nom du fleuve qui baigne les murs de Thèbes ; Flaminius Rufus qui, auparavant, a donné à la ville l’épithète d’Hékatompylos, dit que le fleuve est l’Égypte ; ce n’est pas à lui qu’il convient de s’exprimer ainsi, mais à Homère qui parle expressément, dans L’Iliade, de Thèbes Hékatompylos et qui, dans L’Odyssée, par la bouche de Protée et par celle d’Ulysse, dit invariablement Égypte pour Nil. Au second chapitre, le Romain en buvant l’eau immortelle prononce des mots grecs ; ces mots sont homériques : on les trouvera à la fin du fameux Catalogue des Vaisseaux. Ensuite, dans le vertigineux palais, il parle d’une « réprobation qui était presque un remords ». La formule renvoie à Homère, qui avait conçu cette monstruosité. Pareilles anomalies m’inquiétèrent.
Immortalité et identité
D’autres, d’ordre esthétique, me permirent de découvrir la vérité. Elles sont contenues dans le dernier chapitre ; il y est écrit que je servis sur le pont de Stamford, que je transcrivis, à Bulaq, les voyages de Sindbad le Marin et que je souscrivis, à Aberdeen, à L’Iliade anglaise de Pope. On lit, inter alia : « À Bikanir, j’ai professé l’astrologie ; et aussi en Bohême. » Aucun de ces témoignages n’est inexact ; mais il est significatif de les avoir mis en valeur. Le premier paraît le fait d’un homme de guerre, mais on se rend vite compte que l’auteur s’intéresse non pas aux choses de la guerre, mais au destin des hommes. Ceux qui suivent sont plus curieux.
Immortalité et identité
Une raison obscure et primitive m’obligea à les relater. Je le fis sachant qu’ils étaient pathétiques. Ils ne le sont pas, dits par le Romain Flaminius Rufus. Ils le sont, dits par Homère. Il est étrange que celui-ci copie, au XIII e siècle, les aventures de Sindbad, d’un autre Ulysse, et qu’il découvre, au détour de plusieurs siècles, dans un royaume boréal et dans un langage barbare, les formes de son Iliade. Et quant à la phrase qui reproduit le nom de Bikanir, on voit qu’elle est l’œuvre d’un homme de Lettres, désireux (comme l’auteur du Catalogue des Vaisseaux) d’arborer de superbes vocables 2 . Quand s’approche la fin, il ne reste plus d’images du souvenir ; il ne reste plus que des mots. Il n’est pas étrange que le temps ait confondu ceux qui une fois me désignèrent avec ceux qui furent symboles du sort de l’homme qui m’accompagna tant de siècles. J’ai été Homère ; bientôt, je serai Personne, comme Ulysse ; bientôt, je serai tout le monde : je serai mort.
L’infini temporel
Parmi les corollaires de la doctrine selon laquelle il n’existe aucune chose qui ne soit pas compensée par une autre, il en est un de très peu d’importance théorique, mais qui nous conduisit, à la fin ou au début du X e siècle, à nous disperser sur la surface du globe. Il tient en quelques mots : Il existe un fleuve dont les eaux donnent l’immortalité ; il doit donc y avoir quelque part un autre fleuve dont les eaux l’effacent. Le nombre des fleuves n’est pas infini ; un voyageur immortel qui parcourt le monde, un jour aura bu à tous. Nous nous proposions de découvrir ce fleuve.
L’infini et le sens
- Le contraire de l’eternel retour
La mort (ou son allusion) rend les hommes précieux et pathétiques. Ils émeuvent par leur condition de fantômes ; chaque acte qu’ils accomplissent peut être le dernier ; aucun visage qui ne soit à l’instant de se dissiper comme un visage de songe. Tout, chez les mortels, a la valeur de l’irrécupérable et de l’aléatoire. Chez les Immortels, en revanche, chaque acte (et chaque pensée) est l’écho de ceux qui l’anticipèrent dans le passé ou le fidèle présage de ceux qui, dans l’avenir, le répéteront jusqu’au vertige.
Aleph
- Beatriz
- Carlos Daneri (Dante Alighieri)
- L’aleph sert pour écrire (la bibliothèque, l’intertextualité)
Le poème universel
He visto, como el griego, las urbes de los hombres, Los trabajos, los días de varia luz, el hambre ; No corrijo los hechos, no falseo los nombres, Pero el voyage que narro, es… autour de ma chambre. 17
— C’est une strophe à tous points de vue intéressante, déclara-t-il. Le premier vers rallie les applaudissements du professeur, de l’académicien, de l’helléniste, sinon des érudits à la violette, secteur considérable de l’opinion ; le deuxième passe d’Homère à Hésiode (tout un hommage implicite, sur le frontispice de l’édifice flambant neuf, au père de la poésie didactique), non sans rajeunir un procédé dont l’origine se trouve dans l’écriture, l’énumération. L’amas ou l’accumulation ; le troisième – art baroque, décadent, culte épuré et fanatique de la forme ? – se compose de deux hémistiches jumeaux ; le quatrième, franchement bilingue, m’assure l’approbation sans réserve de tout esprit sensible aux incitations désinvoltes de la facétie. Je ne dirai rien de la rime rare ni de l’art savant qui me permet – sans plaisanterie ! – d’accumuler en quatre vers trois allusions érudites qui embrassent trente siècles de dense littérature : la première à L’Odyssée, la seconde à Les Travaux et les Jours. La troisième à la bagatelle immortelle que nous ont value les loisirs de la plume du Savoyard… Je comprends une fois de plus que l’art moderne requiert le baume du rire, le scherzo. Décidément, Goldoni a la parole !
L’infini spatial actuel
— L’Aleph ? répétai-je. — Oui, le lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l’univers, vus de tous les angles. Je ne révélai ma découverte à personne, mais je revins. L’enfant ne pouvait pas comprendre que ce privilège lui avait été accordé pour que l’homme burinât un jour le poème ! « Zunino et Zungri ne me dépouilleront pas, non, mille fois non ! Code en main, le docteur Zunni prouvera que mon Aleph est inaliénable.
L’Aleph
Peut-être les dieux ne me refuseraient-ils pas de trouver une image équivalente, mais mon récit serait contaminé de littérature, d’erreur. Par ailleurs, le problème central est insoluble : l’énumération, même partielle, d’un ensemble infini. En cet instant gigantesque, j’ai vu des millions d’actes délectables ou atroces ; aucun ne m’étonna autant que le fait que tous occupaient le même point, sans superposition et sans transparence.
L’Aleph
Ce que virent mes yeux fut simultané : ce que je transcrirai, successif, car c’est ainsi qu’est le langage. J’en dirai cependant quelque chose. À la partie inférieure de la marche, vers la droite, je vis une petite sphère aux couleurs chatoyantes, qui répandait un éclat presque insupportable. Je crus au début qu’elle tournait ; puis je compris que ce mouvement était une illusion produite par les spectacles vertigineux qu’elle renfermait. Le diamètre de l’Aleph devait être de deux ou trois centimètres, mais l’espace cosmique était là, sans diminution de volume. Chaque chose (la glace du miroir par exemple) équivalait à une infinité de choses, parce que je la voyais clairement de tous les points de l’univers. Je vis la mer populeuse, l’aube et le soir, les foules d’Amérique, une toile d’araignée argentée au centre d’une noire pyramide, un labyrinthe brisé (c’était Londres), je vis des yeux tout proches, interminables, qui s’observaient en moi comme dans un miroir, je vis tous les miroirs de la planète et aucun ne me refléta,
L’Aleph
je vis dans une arrière-cour de la rue Soler les mêmes dalles que j’avais vues il y avait trente ans dans le vestibule d’une maison à Fray Bentos, je vis des grappes, de la neige, du tabac, des filons de métal, de la vapeur d’eau, je vis de convexes déserts équatoriaux et chacun de leurs grains de sable, je vis à Inverness une femme que je n’oublierai pas, je vis la violente chevelure, le corps altier, je vis un cancer à la poitrine, je vis un cercle de terre desséchée sur un trottoir, là où auparavant il y avait eu un arbre, je vis dans une villa d’Adrogué un exemplaire de la première version anglaise de Pline, celle de Philémon Holland, je vis en même temps chaque lettre de chaque page (enfant, je m’étonnais que les lettres d’un volume fermé ne se mélangent pas et ne se perdent pas au cours de la nuit), je vis la nuit et le jour contemporain, un couchant à Quérétaro qui semblait refléter la couleur d’une rose à Bengale, ma chambre à coucher sans personne, je vis dans un cabinet de Alkmaar un globe terrestre entre deux miroirs qui le multiplient indéfiniment, je vis des chevaux aux crins denses, sur une plage de la mer Caspienne à l’aube, la délicate ossature d’une main, les survivants d’une bataille envoyant des cartes postales,
L’Aleph
je vis dans une devanture de Mirzapur un jeu de cartes espagnol, je vis les ombres obliques de quelques fougères sur le sol d’une serre, des tigres, des pistons, des bisons, des foules et des armées, je vis toutes les fourmis qu’il y a sur la terre, un astrolabe persan, je vis dans un tiroir du bureau (et l’écriture me fit trembler) des lettres obscènes, incroyables, précises, que Beatriz avait adressées à Carlos Argentino, je vis un monument adoré à Chacarita, les restes atroces de ce qui délicieusement avait été Beatriz Viterbo, la circulation de mon sang obscur, l’engrenage de l’amour et la transformation de la mort, je vis l’Aleph, sous tous les angles, je vis sur l’Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l’Aleph et sur l’Aleph la terre, je vis mon visage et mes viscères, je vis ton visage, j’eus le vertige et je pleurai, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les hommes usurpent le nom, mais qu’aucun homme n’a regardé : l’inconcevable univers. Je ressentis une vénération infinie, une pitié infinie.
Conclusions (?)
Nos questions de départ
- Qu’est-ce que la littérature?
- Qu’est-ce que la philosophie?
- Qu’est-ce que ce et?
Qu’est-ce que la littérature?
- Des humanae litterae à la formation d’un “champ”
- Littérature, mimesis, poésie, roman, fiction
- La question du langage
Qu’est-ce que la philosophie?
- Le langage philosophique
- La rationalité
Qu’est-ce que ce et
- Une opposition?
La littérature pour faire philosophie
- Sartre, Proust, Borges, de Beauvoir
- L’importance de la littérature (parce qu’elle est philosophique?)
La littérature critique la philosophie
- Aristophane, Valéry, Voltaire
La philosophie pense la littérature
- Sartre, de Beauvoir, Platon, Aristote…
Des questions institutionnelles
- Qui définit ce qui est littérature?
- Qui définit ce qui est philosophie?
- Quelle est la place des intellectuels aujourd’hui?